DERRIÈRE LES MURS :
MAINTENIR UN LIEN MALGRÉ LA DÉTENTION
La prison est une micro-société. Tandis que la vie extérieure suit son cours, les détenus, eux, en sont coupés. Pourtant, ils tentent, tant bien que mal, de maintenir un lien avec ce monde dont ils sont physiquement éloignés. Ne plus voir sa famille et ses proches est une épreuve, d’un côté comme de l’autre. Pour pallier cette séparation, plusieurs dispositifs existent en France afin de préserver le lien social des personnes incarcérées. Le droit de visite constitue souvent le seul contact des détenus avec l’extérieur.
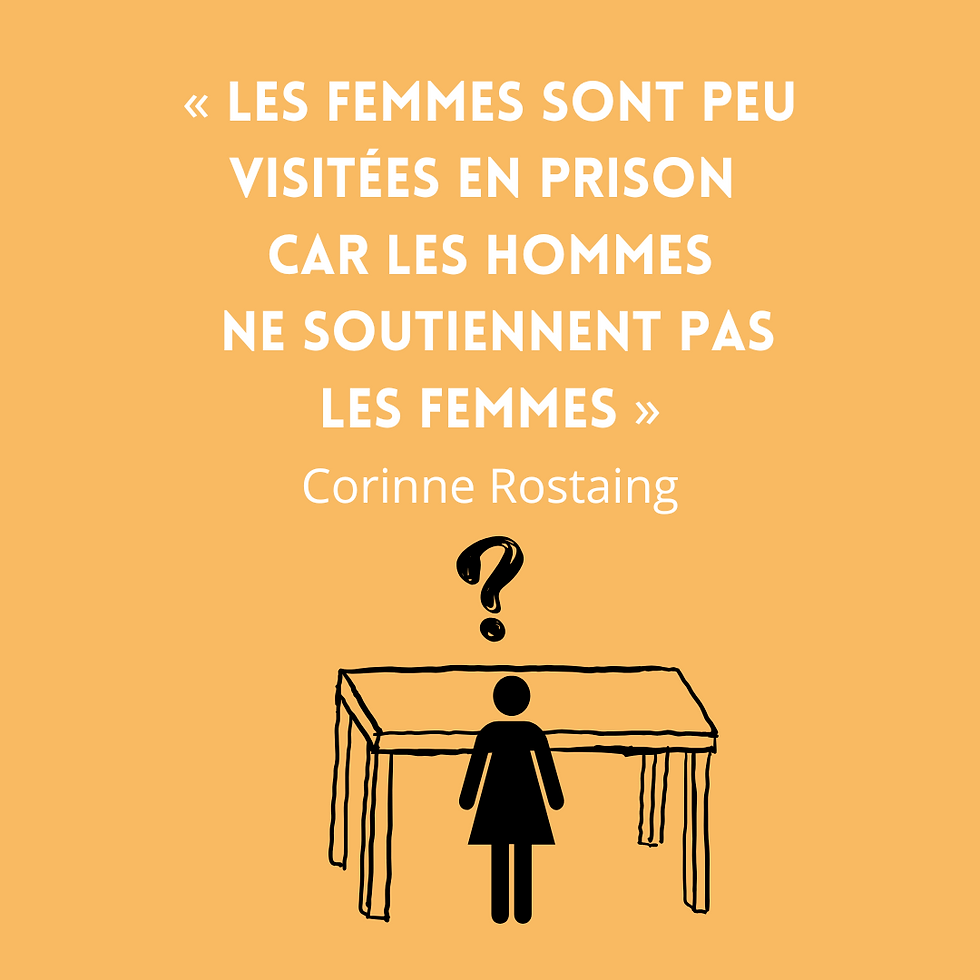
L’accès aux parloirs est régi par une procédure stricte. Pour rendre visite à une personne détenue, il faut obtenir un permis auprès du juge d’instruction. Une fois accordé, l’administration pénitentiaire doit à son tour donner son aval.
La durée des parloirs varie selon les établissements, allant de 45 minutes à 2 heures. Il est parfois possible de bénéficier de deux ou trois parloirs par semaine, avec trois ou quatre personnes au maximum. C’est souvent le moment où la personne détenue peut recevoir du linge, des documents, ou simplement voir un visage familier. La personne qui vient rendre visite au parloir doit obligatoirement franchir les portiques de sécurité avec un détecteur de métaux. Il est formellement interdit d’apporter son téléphone portable ou tout objet connecté.
Kerya, que nous avons pu rencontrer, témoigne de sa réalité : sa famille lui a tourné le dos quand elle a été incarcérée. Sa sœur la considère comme « la honte de la famille ». Seul son père est venu lui rendre visite à quelques reprises.
Son histoire peut sembler exceptionnelle, pourtant, la sociologue, Corinne Rostaing, spécialiste du milieu carcéral met en lumière une réalité bien plus large « Les femmes sont peu visitées en prison car les hommes ne soutiennent pas les femmes ». Les liens avec la famille et les proches sont souvent rompus, car une femme est « plus jugée et a moins le droit à l’erreur ».
Au Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, 2284 parloirs ont eu lieu en 2024 : 764 pour la maison d’arrêt et le quartier de prise en charge de la radicalisation et 1520 pour le centre de détention.
D’autres dispositifs existent, comme les permissions de sortie. Selon l’article 723-3 du code de procédure pénale, « la permission de sortir autorise un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution ». Ces sorties permettent à la fois de préparer à la réinsertion sociale et de maintenir des liens avec ses proches. Elles peuvent durer de quelques heures à trois jours, mais restent inaccessibles aux personnes en détention provisoire et aux condamnés à perpétuité. Ne pas rentrer dans les temps impartis est assimilé à une évasion, passible de trois ans de prison supplémentaires et de 45 000 euros d'amende. En 2019, 71 532 permissions de sortie ont été accordées en France, selon l'Observatoire International des Prisons (OIP).
Pour ceux qui n’ont ni permission de sortie ni aménagement de peine, il existe les unités de vie familiale (UVF). Ces espaces, introduits en 2003 au Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et généralisés en 2009, sont des appartements de deux à trois pièces situés dans l’enceinte pénitentiaire, mais hors des zones de détention.
Ils permettent aux détenus de retrouver leurs proches dans un cadre plus « intime », pour une durée allant de 6 à 72 heures. Pour en bénéficier, une double demande écrite est nécessaire, l’une de la part de la personne incarcérée, l’autre du visiteur. Comme pour les parloirs, un contrôle sécuritaire via un portique métallique est effectué avant chaque visite.

Crédit photo : Entre 4 murs
